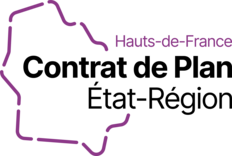Projets financés AAP 2024

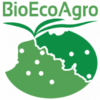
SWERTILIN
Implication de la swertisine et de la swertiajaponine dans la tolérance au stress froid chez le lin (Linum usitatissimum L.)
Le réchauffement climatique est associé à une augmentation progressive de la fréquence des accidents climatiques. Afin de pallier cette évolution et maintenir une production agricole répondant aux besoins de nos sociétés, la modification des pratiques culturales des plantes de grandes cultures est nécessaire. Pour s’adapter à l’environnement de demain et assurer la transition écologique et environnementale, l’utilisation de nouvelles variétés représente une démarche pertinente. Ainsi, chez le lin fibre, une espèce d'intérêt régionale, la création de variétés d’hiver est une solution judicieuse. Semé fin septembre, le lin d’hiver s’enracine pendant l’automne et est bien implanté au printemps lors de la reprise de végétation. Son système racinaire développé lui permet alors d’aller puiser l’eau en profondeur et d’être plus tolérant que le lin de printemps lors de faibles précipitations au printemps (comme en 2022). De même, sa maturité plus précoce à celle du lin de printemps, lui permet d’être arraché plus tôt (début juin) et d’être moins exposé aux conditions arides de l’été. Malgré ces avantages, le nombre de variétés disponibles de lin d’hiver est encore limité et l’absence d’informations sur les mécanismes impliqués dans la tolérance au froid chez le lin ralentit la sélection variétale. Ainsi, l’absence de biomarqueur limite les sélectionneurs dans leur démarche qui repose aujourd'hui sur des méthodes empiriques. Deux marqueurs potentiels des lins d'hiver ont été récemment identifiés : des flavones C-glycosides. L'objectif de ce projet est de déterminer définitivement le rôle de ces molécules dans la tolérance au froid et ainsi fournir aux sélectionneurs des bases solides pour la sélection assistée par marqueurs.
Porteur : David Gagneul - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)
Partenaire : Laurent Gutierrez - Plateforme CRRBM & Serres (UPJV)

Logo CRRBM - Projet SWERTILIN

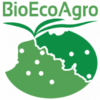
MICROBIOCHIC
L’effet du microbiote de la chicorée sur la composition de la plante
La chicorée industrielle (Cichorium intybus var. sativum) est reconnue comme aliment fonctionnel et différentes classes de molécules présentes dans la plante ont été identifiées comme responsables des effets bénéfiques sur la santé animale et humaine (Fouré et al., 2018 ; Pouille et al., 2020 ; Pouille et al., 2022). La composition chimique de la chicorée et de ses différentes denrées alimentaires peut varier en fonction du génotype et des conditions de culture. L’écosystème microbien associé à la plante est également susceptible d’influencer sa composition. Nous avons analysé le microbiote de la rhizosphère, le microbiote endophyte de la racine et aussi celui associé aux graines de chicorée, par des méthodes de séquençage ciblé (16S et ITS). En parallèle nous avons étudié la composition de la plante et les variations qualitatives et quantitatives des métabolites primaires et spécialisés en fonction de l’évolution du microbiote associé à la plante. Nous avons ainsi identifié un certain nombre d’espèces microbiennes associées à la chicorée industrielle et qui sont en lien avec la composition phytochimique de la plante. Suite à cette cartographie des taxons bactériens et fongiques, les microorganismes cultivables qui présentent un intérêt pour la production des substances bioactives, pour l’extraction des phosphates, pour la défense des plantes, la croissance et la résistance à la sècheresse, seront isolés et caractérisés pour proposer des solutions de biocontrôle et d’amélioration de la qualité alimentaire de la chicorée.
Porteur : Anca Lucau - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)
Partenaire : Elodie Choque - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (UPJV)

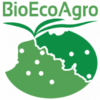


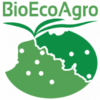
IMPECTA
IMmobilisation des PECTine Acétylestérases dans l’amélioration de leur activité catalytique sur les pectines de la betterave sucrière
Les pectines sont des polysaccharides complexes, riches en résidus d’acide galacturonique (GalUA). Les résidus GalUA peuvent-être acétylés en position O2 et/ou O3 et leur degré d’acétylation peut être modulé par
l’action des pectine acétylestérases (PAE, EC 3.1.1.6) au sein de la paroi. La betterave sucrière (Beta vulgaris spp vulgaris) est une culture d’intérêt agro-économique en Région Hauts de France mais dont les co-produits sont, peu valorisés. Les pectines, qui représentent 20% de la biomasse sèche de la pulpe de la betterave sucrière, possèdent peu de propriétés gélifiantes, qui est lié à leur fort degré d’acétylation (>20%). L’action de PAE exogènes sur ces pectines pourrait contribuer à l’amélioration de leur propriété gélifiante et donc leur valorisation. Cependant, la fragilité des enzymes, notamment en solution, limite souvent leur conservation. Une alternative serait de les immobiliser sur des nanoparticules afin de pouvoir préserver leur activité catalytique dans la durée. L’objectif du projet IMPECTA est d’immobiliser sur des nanochitosanes des PAE de la betterave sucrière, produites en système hétérologue chez la levure Pichia Pastoris et purifiées, puis de tester l’action de ces enzymes immobilisées sur l’amélioration des propriétés gélifiantes des pectines de betterave.
Porteurs : Catherine Rayon - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (UPJV), Romdhane Karoui UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (UArtois)
Partenaire : Albert Nguyen Van Nhien - LG2A (UPJV)




CoPoS
Co-dissolution de Polysaccharides et de Soie dans des solvants verts pour la
formation de biomatériaux
Les polymères naturels semi-cristallins (cellulose, chitine, soie, …) sont une ressource quasi-inépuisable, renouvelable et propre à la conception de matériaux aux propriétés mécaniques et/ou biologiques améliorées. Les applications de ces polymères potentiellement réticulés et/ou fonctionnalisés sont versatiles et vont de la formation de gels leurres des milieux biologiques au remplacement de polymères synthétiques (plastiques). Mais, ces polymères naturels présentent un haut degré de cristallinité associé à un important réseau de liaisons hydrogène leur conférant un caractère récalcitrant à leur solubilisation et traitement.
La première étape de ce projet consiste en l’extraction/dissolution des polymères de la biomasse dans des solvants verts suivie d’une seconde étape visant à regénérer un matériau hybride (polysaccharides + soie) sous forme de film/matrice/gel. Les matériaux obtenus seront alors soumis à des tests de traction afin de comparer leurs propriétés mécaniques à celles des matériaux de référence.
L’objectif du projet est de proposer une gamme de solvants verts (liquides ioniques (IL), solvants eutectiques profonds (DES)) capables de dissoudre puis de regénérer un gel mélangeant de la nanocellulose/nanochitine et de la soie tout en présentant des propriétés mécaniques améliorées, mais aussi des matériaux de types composites souples et rigides à base de ces blends de polymères naturels. En parallèle du volet expérimental, des études par modélisation moléculaire sont menées pour tester et prédire les capacités de dissolution de nombreux solvants.
Porteur : Christine Cézard - Laboratoire de Glycochimie et des Agroressources d’Amiens (LG2A) – UR 7378 (UPJV)
Partenaire : Nicolas Joly - Unité Transformations et Agroressources, UTA – ULR 7519 (UArtois)




TRIGLYOL
Synthèses et caractérisations de triglycérides polyhydroxylés
Les triglycérides font partie de la famille des lipides et peuvent se substituer aux ressources fossiles pour la production de composés chimiques. Dans le cas des acides gras insaturés, les insaturations C=C peuvent ainsi servir de base afin d’introduire des fonctions chimiques d’intérêt. Depuis septembre 2023, dans le cadre de la thèse de M. Abdelhadi Zouhair, il a été montré que l’utilisation d’un système catalytique [rhodium/dérivés azotés] permettait de fonctionnaliser les insaturations C=C des huiles végétales et leurs dérivés par des fonctions alcool primaire suite à une réaction tandem (hydroformylation / hydrogénation). Les polyalcools ainsi préparés seront utilisés comme macro-initiateurs pour la réaction de polymérisation par ouverture de cycle des monomères tels que la ɛ-caprolactone et des lactides pour préparer des poly(ɛ-caprolactone)s et poly(lactide)s biosourcés, greffés sur les huiles hydroxylées. Afin de faciliter la réaction de polymérisation, il est essentiel de connaitre le plus précisément possible le nombre et la position des fonctions alcool primaire sur les chaines alkyle des triglycérides. Dans ce contexte, le but de ce projet TRIGLYOL est de fonctionnaliser par réaction d’hydrohydroxyméthylation (HHM) différents lots d’huiles végétales et de leurs dérivés (UCCS), puis d’analyser les différents produits obtenus (PFA).
Porteur : Michel Ferreira - UCCS (UArtois)
Partenaire : Serge Pilard - PFA (UPJV)

Logo PFA - Projet TRIGLYOL


MatHyBioCat
Matériaux hybrides pour la purification catalytique du CO2 issu de la combustion du biogaz
La principale valorisation énergétique du biogaz est basée sur sa combustion pour obtenir de l’électricité ou de la chaleur. Cette combustion entraine des émissions de CO2 qu’il faut purifier pour une valorisation ou un stockage du CO2. En effet, la présence de NOx peut conduire à des réactions secondaires, disqualifiant le CO2 pour une valorisation ultérieure. Pour atteindre une plus grande pureté en CO2, une solution attrayante est la réduction catalytique sélective (SCR) consistant à réduire les NOx tout en oxydant le CO/HC. Celle-ci n’a cependant pas été optimisée pour la combustion industrielle du biogaz. Notre objectif est donc de développer ce process SCR par l’utilisation d’un catalyseur performant et peu onéreux. Lors de travaux récents, il a été montré que des oxydes de métaux de transition à base de cuivre et cobalt issus de la calcination d’Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) conduisaient à de très bons catalyseurs pour la purification du CO2. Dans la continuité de l’obtention de catalyseurs à la fois plus actifs et sélectifs, différentes stratégies sont envisagées. Une première approche est basée sur l’influence du mode de synthèse des précurseurs HDL. (synthèse hydrothermale, par activation aux micro-ondes ou par mécanochimie) permettra l’obtention de matériaux hydrotalcites avec une meilleure cristallinité. De plus, l’amélioration de la taille et la dispersion de la phase active pourra être envisagée par l’utilisation d’agents organiques comme les cyclodextrines dont l’efficacité est connue dans la préparation de catalyseurs hétérogènes. Une seconde approche sera basée sur l’influence du post-traitement sur la composition des oxydes obtenus.
Porteur : Stéphane Siffert - Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV), équipe Traitement Catalytique et Energie Propre (ULCO)
Partenaire : Sébastien Noël - Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS), équipe Catalyse Supramoléculaire (CASU) (UArtois)