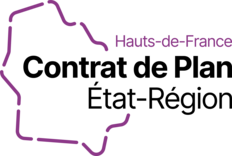Projets financés AAP 2023


CLIP
Cyclodextrines et Lipopeptides : Interactions et Potentialités
Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’évaluer l’association de deux familles de composés biosourcés, aux propriétés complémentaires : des métabolites microbiens et des oligosaccharides , domaines d’expertise de l’UMRt BioEcoAgro-ULille/ULiège et du LG2A-A2U UPJV respectivement.
Il s’agira dans un 1er temps d’étudier l’influence de différents oligosaccharides sur la solubilité et les propriétés physico-chimiques des métabolites, au travers d’analyses physico-chimiques moléculaires (RMN) et supramoléculaires (taille et forme des objets en solution). Dans un second temps, les activités biologiques des assemblages seront comparées aux molécules isolées.
Porteurs : Florence Djedaini-Pilard et Veronique Bonnet - LG2A (UPJV)
Partenaires : Philippe Jacques et François Coutte - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)

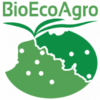

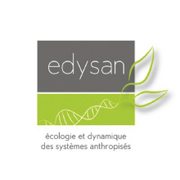
3C2B
Combinaison au Champ du Couvert, de la Biostimulation & du Biocontrôle
Le projet 3C2B vise à évaluer l'impact de l'application de produits microbiens sur une rotation agricole régionale dans les Hauts-de-France. Cette étude sera la première du genre dans la région et permettra d'évaluer les avantages de la biostimulation et du biocontrôle à grande échelle. Les produits microbiens utilisés seront des bactéries rhizosphériques bénéfiques pour les plantes (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR) et des métabolites bactériens de la classe des lipopeptides qui agiront en remplacement des fongicides. L'étude se concentrera sur le blé, le lin et la pomme-de-terre, avec des évaluations agronomiques traditionnelles ainsi que des analyses moléculaires et biochimiques pour caractériser la réponse des plantes aux maladies fongiques et suivre l'évolution des communautés microbiennes. Le projet 3C2B répondra à plusieurs questions essentielles, notamment sur l'impact potentiel de l'application foliaire d'agents de biocontrôle sur les communautés microbiennes du sol, la capacité des PGPR de type Sphingomonas à agir comme agents de biocontrôle via la production de métabolites pouvant moduler les défenses des plantes, et l'efficacité de l'utilisation combinée de PGPR et de lipopeptides par rapport à leur utilisation individuelle après avoir considéré l'interaction entre les lipopeptides et les PGPR.
L'objectif global du projet est d'évaluer l'intérêt de ces biosolutions pour les agriculteurs locaux et de promouvoir l'utilisation d'options alternatives aux intrants minéraux et synthétiques dans la région. Avec des résultats positifs, cette étude pourrait conduire à une adoption plus large de pratiques agricoles durables dans les Hauts-de-France et dans le territoire national.
Porteur : Jéröme Duclercq - UMR7058 UPJV/CNRS - EDYSAN (UPJV)
Partenaire : Valérie Leclère - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)

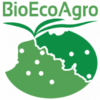

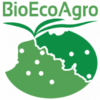

ProMoBio
Proposition de nouvelles molécules biosourcées, d’origine végétale, dans la lutte contre les maladies des plantes
Le projet de thèse s’inscrit dans le cadre de l’axe 2 du plan ECOPHYTO II+. L’objectif est de développer l’utilisation de substances naturelles de structures originales en tant que stimulateur des défenses naturelles (SDN) des plantes. Ces molécules, les oligogalacturonides (OG), dérivées des pectines de la paroi végétale, sont générées à partir de différentes sources végétales (produits secondaires des industries agricoles et agroalimentaires par ex.) par l’action d’enzymes d’origine végétale produites en systèmes hétérologues, les polygalacturonases. La structure fine des OG (degrés de méthylation/acétylation et/ou de polymérisation) est analysée par LC/MS. Il a été montré que certains OG agissent comme des molécules élicitrices des SDN via l’induction de la production d’espèces réactives de l’oxygène et de l’expression des gènes de défenses, impliqués dans la protection des plantes contre divers agents pathogènes. En revanche, le panel des OG testés à ce jour reste faible. L’efficacité des OG, produits pendant la thèse, est évaluée en mettant en œuvre des tests de protection du blé contre Blumeria graminis f.sp tritici (Bgt), agent pathogène de l’oïdium. Les mécanismes de défenses induits chez le blé par les OG les plus efficaces seront étudiés en mesurant l’expression de gènes marqueurs de différentes voies de défense par RTqPCR. Par ailleurs, l’éventuel effet biopesticide des OG (effet direct) sera étudié grâce à des tests anti-germinatifs contre les spores de (Bgt). A terme, ces OG pourront être utilisés comme moyens alternatifs de biocontrôle des agents phytopathogènes et de protection des cultures pour réduire l’usage des traitements chimiques actuellement disponibles.
Porteur : Corinne Pau-Roblot - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro-BIOPI (UPJV)
Partenaire : Anissa Lounès Hadj-Sahraoui - UR4492 UCEIV (ULCO)




CELIN
Eco-Procédé Chimio-Enzymatique pour la Fonctionnalisation de l’Huile de Lin
Les huiles végétales sont des ressources renouvelables pouvant se substituer aux ressources fossiles pour la production de composés chimiques. Parmi les différentes huiles disponibles sur le marché, on trouve l'huile de lin. La France est le leader mondial de la culture du lin avec 85 % de la production, notamment dans les Hauts-de-France. L’huile de lin est un triglycéride intégrant majoritairement 5 acides gras : l’acide palmitique, l’acide stéarique, l’acide oléique, l’acide linoléique et l’acide linolénique. L’huile de lin sera fonctionnalisée par des fonctions esters ou des fonctions amines par des procédés chimio-enzymatiques (catalyse homogène / catalyse enzymatique) dans des systèmes monophasique ou biphasique (liquide/liquide). Les composés synthétisés pourront trouver des applications en tant que plastifiants ou monomères pour la synthèse de polymères. Le projet impliquera 2 équipes de recherche, l’une de l’UCCS (UArtois) et l’autre de l’UMRtBEA (ULille), dans le cadre de la thèse de M. Abdallah (thèse co-financée par la Région HdF et l’UArtois) qui a débutée en octobre 2022.
Porteur : Sébastien Tilloy - UCCS (UArtois)
Partenaire : Rénato Froidevaux - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)

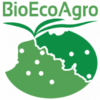

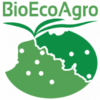

PHYTOIL
Caractérisation des modes d’action d’huiles essentielles en vue de formuler un produit de biocontrôle permettant de lutter contre Phytophthora infestans sur pommes de terre
L’apparition récente de pathovars de Phythophtora infestans (P.i. mildiou) particulièrement agressifs cause des dégâts sévères aux cultures de pomme de terre (PdT). La demande sociétale actuelle vise à diminuer l’utilisation de pesticides issus de la synthèse chimique et à développer des bio-pesticides à faible impact environnemental. Plusieurs huiles essentielles (HEs) ont déjà montré une très bonne activité fongicide contre P.i. (in vitro/vivo), en plus de présenter une très faible phytotoxicité sur PdT. Ce sont donc d’excellentes candidates pour la formulation d’un bio-fongicide. Néanmoins, le mode d’action de ces huiles essentielles n’est pas connu.
Le projet Phytoil sera décliné selon les trois étapes suivantes :
- Cinq huiles essentielles à activité anti-oomycète et faible phytotoxicité seront sélectionnées sur base d’études antérieures. Elles seront testées sur différents couples hôtes-pathogènes (trois variétés choisies de PdT et trois pathovars agressifs récemment isolés dans nos régions : EU-13-A2, EU-36-A2, EU-37-A2 [Euroblight]), menant à la sélection d’une HE.
- Les modes d’action des constituants majoritaires seront étudiés en se focalisant plus particulièrement sur la pénétration des molécules dans l’oomycète. Pour cela une étude détaillée des lipides membranaires est nécessaire. Elle sera combinée à une étude de biophysique in vitro/silico visant à comprendre l’interaction fongicide/lipides membranaires.
- La compréhension de ces modes d’action permettra le développement d’une formulation à activité fongicide optimale en conditions agronomiques réalistes (mouillabilité, pénétration, …).
L’objectif finale du projet est le dévelopement d’une formulation efficace d’une huile essentielle pour la protection de la pomme de terre à travers un réseau de recherche collaborative renforcé en Hauts-de-France.
Porteur : Eric Gontier - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro-BIOPI (UPJV)
Partenaire : Jérôme Muchembled - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro-BIOPI (ULille - Junia)


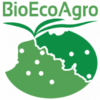

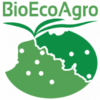
CARBIOCHIC
Caractérisation moléculaire des voies de biosynthèse de métabolites spécialisés chez la chicorée
Il est aujourd'hui admis que les métabolites spécialisés participent largement aux interactions des plantes avec leur environnement. Ces composés représentent également une ressource inestimable pour l’homme. Ils sont utilisés en tant qu’actifs biologiques (principes actifs de médicaments et de cosmétique, antioxydants, insecticides, répulsifs…), en tant qu’actifs fonctionnels (arômes, colorants, parfums…) et en tant que molécules de base pour la synthèse chimique (synthèse asymétrique de molécules chirales en particulier). La valorisation optimale de ces composés repose sur la capacité à les produire en quantité suffisante. Ceci nécessite la caractérisation fine de tous les déterminants moléculaires à l’origine de leur biosynthèse que ce soit en vue de l’entreprise de démarche de sélection variétale ou d’établissement de systèmes de bioproduction en système hétérologue.
La chicorée industrielle, une espèce emblématique de la région Hauts-de-France, produit et accumule de l'acide chlorogénique (acide monocaféoyl quinique) ainsi que 3 autres composés phénoliques proches sur le plan structural : les acides isochlorogénique (acide dicaféoyl quinique), caftarique (acide monocaféoyl tartrique) et chicorique (acide dicaféoyl tartrique). Les propriétés biologiques de ces molécules, largement décrites dans la littérature, sont nombreuses. Seule la voie de biosynthèse de l'acide chlorogénique a été décrite chez la chicorée. Celles des 3 autres composés sont inconnues. La description fine de ces voies permettra d'une part, d'envisager la bioproduction de ces molécules d'intérêt en système hétérologue et d'autre part, de décrire leurs rôles physiologiques chez les plantes. Plusieurs gènes candidats ont déjà été identifiés mais restent à caractériser. Cet objectif constitue l'objet de cette demande.
Porteur : Jean-Louis Hilbert - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)
Partenaire : David Mathiron - PFA (UPJV)

Logo PFA - Projet CARBIOCHIC

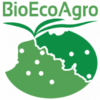
NETWHOP
Exploration de la diversité chimique des houblons sauvages de la région Hauts-de-France en conditions ex-situ par des méthodes de réseaux moléculaires pour des applications agronomiques, agro-alimentaires et thérapeutiques
Des études récentes montrent que la diversité génotypique et phénotypique, y compris chimique, des houblons sauvages est plus importante que celle des houblons commerciaux. Les houblons sauvages sont ainsi reconnus pour être une source de caractères d’intérêt pour la sélection variétale et pour des applications agro-alimentaires et thérapeutiques. Cette diversité génétique et chimique a été confirmée par notre équipe dans le cadre d’une étude menée sur 50 pieds de houblons sauvages collectés en région Hauts-de-France en conditions in-situ. Ces 50 individus ont été conservés ex-situ en houblonnière expérimentale et sous forme de vitro-plants. L’objectif de ce projet est donc de poursuivre la caractérisation chimique de ces houblons sauvages conservés en houblonnière par le biais de différentes approches s’appuyant sur la spectrométrie de masse haute résolution et en tandem (MS/MS) pour identifier des composés originaux : profilage chimique ciblé et non ciblé et surtout réseaux moléculaires. Cette caractérisation chimique pourrait permettre de découvrir des caractéristiques organoleptiques d'intérêt pour les brasseries, en parallèle de tests d’analyses sensorielles, mais aussi conduire à des applications potentielles pharmaceutiques et agronomiques. Ces informations seront utilisées à deux fins : approfondir l'investigation du potentiel pharmacologique de certains métabolites du houblon et amorcer le développement de variétés adaptées au terroir régional dans un contexte de réchauffement climatique.
Porteur : Céline Rivière - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)
Partenaire : Roland Molinié - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro-BIOPI (UPJV)

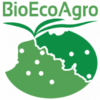


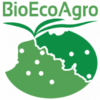
COSMESTIL
Développement d’une formulation cosmétique naturelle et biodégradable délivrant des composés phénoliques extraits de chevelus racinaires de Vitis vinifera
Les cosmétiques contenant des ingrédients naturels sont considérés comme plus sûrs et sécurisants et gagnent ainsi en popularité. Il a été montré que certains composés phénoliques de plantes sont capables de protéger voire même de soigner ou guérir la peau. La vigne en est l’une des principales sources (flavonoïdes, stilbènes, proanthocyanidines). Les composés phénoliques de la vigne ont d’ailleurs de nombreuses applications en cosmétique et en agro-alimentaire (lotions, crèmes et compléments alimentaires). L’objectif de ce projet de thèse est de valoriser la production en condition contrôlée de ces métabolites spécialisés de la vigne, maîtrisée depuis longtemps par l’un des deux laboratoires, en développant une formulation cosmétique entièrement naturelle et biodégradable permettant la libération ciblée de principes actifs antioxydants. L’originalité principale réside dans l’établissement d’une nouvelle méthode de formulation basée d’une part sur la quantité de molécules absorbables/métabolisables par la peau (mise en oeuvre d’un modèle de peau 3D in vitro construit à partir d’une culture de kératinocytes – Equipe 7 – Université de Lille), et d’autre part sur la quantité de molécules pouvant être apportées par la formulation (mise en place d’un test de diffusion dans un simulant lipidique équivalent au sébum cutané – Equipe 5 – A2U). L’obtention de ces deux données permettra de formuler un principe actif dans une quantité efficace évitant les pertes, donc une surproduction, et limitant toujours plus l’impact que le produit fini pourrait avoir sur l’environnement.
Porteur : Rozenn Ravallec - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (ULille)
Partenaire : Elodie Choque - UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro (UPJV)

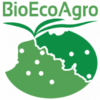


NBPDeaux
NanoBioPolymères pour la Dépollution des eaux
Afin de dépolluer les eaux usées, l’adsorption est probablement l’une des techniques les plus utilisées. Les charbons actifs sont probablement les plus répandus en milieu industriels. Dans le cadre de la bioéconomie, les biopolymères présentent un intérêt pour cette application pour leur abondance naturelle et leur non-toxicité. Dans ce projet, nous nous intéressons à la nanochitine/chitosane et leur modification chimique en associant plusieurs techniques de chimie durable (utilisation de solvant de type NADES ‘Natural deep Eutectic Solvent’, mécanochimie). Une fois caractérisés, ces supports seront étudiés seuls pour leur aptitude à adsorber deux polluants métalliques (Cd, Ni) et in fine mélanger à d’autres biopolymères pour la fabrication d’hydrogels qui seront également étudiés en dépollution.
Porteur : Christophe Waterlot - LGCgE (Junia)
Partenaire : Albert Nguyen Van Nhien - LG2A (UPJV)